|
|
Dès huit ans, John Carpenter
(né en 1948) commence à filmer avec la caméra de son père des explosions,
des coups de revolver, et même un peu d'animation image par image, procédé
bien utile pour animer les créatures monstrueuses dont il peuple ses films.
En effet, l'enfant se met rapidement à raconter des histoires. Et dans ses
courts-métrages, des extra-terrestres géants envahissent la Terre, son héros
se bat contre Godzilla, et le western ou le péplum flirte allègrement avec
le fantastique. Puis, devenu étudiant de cinéma, il s'impose comme l'un des
plus brillants élèves de sa promotion. A 22 ans, il reçoit un oscar pour son
court-métrage d'école, The Resurrection of Bronco Billy, qu'il a écrit, monté
et co-réalisé. II en a même composé la musique. Ce film raconte l'histoire
d'un jeune homme qui, pour fuir la réalité, se réfugie dans un monde de western.
En 1975, le public découvre son premier film, un ovni cinématographique qui
oscille constamment entre hommage et parodie. Darkstar , à l'origine, ne devait
être qu'un moyen-métrage de fin d'études, tourné avec les moyens du bord,
sur un scénario d'un ami de fac de John Carpenter, Dan 0'Bannon (futur scénariste
d'Alien et réalisateur du Retour des Morts-Vivants !). Grâce à un producteur
et à un distributeur enthousiasmés par le projet, le film devient un long-métrage
et connaît une exploitation commerciale en salles. Mais l'aventure délirante
de ce vaisseau spatiale délabré qui erre dans l'espace, avec à son bord une
équipe de zinzins, déconcerte. Le film est un échec. II révèle cependant le
talent de son réalisateur qui a dû déployer des trésors d'ingéniosité dans
sa mise en scène pour exploiter au mieux un budget ridicule (60 000 $). Et
John Carpenter retiendra tellement bien les leçons de cette première expérience
qu'il deviendra l'un des nouveaux maîtres des séries B, ces films à petits
budgets qui remplacent le manque de moyens par une inventivité salutaire (en
tout cas quand le réalisateur a du talent!) .
Après Darkstar (qui atteindra
plus tard le statut envié de film "culte"), le cinéaste se lance
dans un western contemporain électrisant, Assaut (1976). Encore un petit budget,
pour un film nerveux et violent dans lequel
une bande de voyous assiège un commissariat toute une nuit. Avec un sens aigu
du cadrage et du rythme, Carpenter installe progressivement une ambiance angoissante,
joue avec toutes les possibilités de son décor et fait monter la tension jusqu'à
son paroxysme. Pour ce film, il est une fois de plus réalisateur, musicien,
scénariste et monteur. L'une des caractéristiques du cinéaste est justement
cette polyvalence qui lui assure un plus grand contrôle artistique sur ses
films. Ainsi, il est responsable de leurs conceptions pratiquement de A à
Z, ce qui confère à ses films un style unique et une cohérence complète entre
la forme et le fond.
Son film suivant, La Nuit des Masques (Halloween) en 1978, fait date dans
l'histoire du cinéma fantastique-horrifique. Carpenter l'a conçu à la base
pour qu'il provoque les mêmes émotions qu'une attraction foraine de maison
hantée. Un tueur s'échappe d'un asile, la nuit d'Halloween et sème les cadavres
sur sa route. Seul le docteur Loomis peut l'arrêter. Loomis est joué
par Donald Pleasance, le spécialiste des seconds rôles de séries B et un futur
habitué de l'univers de John Carpenter. A ses côtés, on découvre une débutante,
Jamie Lee Curtis. Musique lancinante et répétitive, séquences en caméra subjective
qui font prendre au spectateur le point de vue du tueur ou de l'héroïne, symboliques
sexuelles et références multiples au cinéma d'épouvante, font de ce film un
suspense terrifiant pour l'époque avec plusieurs niveaux de lecture. Le film
connaît un immense succès quand il ressort (la première sortie avait été un
désastre) lors de la fameuse fête dont il est question. Du coup, La Nuit des
Masques lance la mode du "psycho-killer" et engendre tout un lot
de films dans lesquels des meurtriers fous massacrent des innocents à tour
de bras (comme la série des "Vendredi 13" ou plus récemment des
"Freddy"...). Bien sûr, Halloween a vieilli et, à côté des copies
qui vont toujours plus loin dans l'hémoglobine, il peut paraître
un peu pâle. II
n'en reste pas moins un film de référence du genre pour tous les cinéphiles
et sera d'ailleurs suivi par quatre autres volets. Avec ce succès, John Carpenter
devient un réalisateur très sollicité .
Deux ans plus tard, il tourne FOG, dans
lequel des fantômes de marins reviennent demander réparation auprès des descendants
de leurs assassins. Ils se servent du brouillard pour pénétrer dans la ville
et commettre leurs forfaits. En 1981, le cinéaste retrouve Donald Pleasance
et ajoute à sa liste d'acteurs fétiches un autre inconnu, Kurt Russel (découvert
dans Le Roman d'Elvis, la biographie qu'a réalisée Carpenter pour la TV).
Si Russel tient maintenant la vedette dans des mégas -productions style Stargate,
il le doit sans nul doute au réalisateur qui l'a imposé comme un nouveau modèle
de héros. Dans NEW-YORK 1997, il joue un hors-la-loi qu'on pourrait croire
tout droit sorti d'un western. Cet "outlaw" est largué dans la jungle
urbaine de la presqu'île de Manhattan - devenue une Prison de haute sécurité,
ceinturée de murs infranchissables - pour récupérer le Président qui a eu
la mauvaise idée de s'y écraser avec son avion. Le film est un énorme succès.
II servira de modèle à toute une génération de films d'aventures futuristes
(ratés). Actuellement Carpenter prépare une suite, Escape from L.A..
Si Fog et et New-York 1997 font un peu
daté, il faut reconnaître que les univers angoissants décrits par le réalisateur
à l'époque étaient des plus modernes et imaginatifs. The Thing, qui suit en
1982, toujours avec Kurt Russel, reste par contre indémodable. C'est la relecture
d'une nouvelle déjà transposée à l'écran en 1951 ( "La Chose d'un Autre
Monde" de C.Nyby, produit par H.Hawks). L'équipe d'une station polaire
est confrontée à une créature extra-terrestre qui peut prendre à volonté l'apparence
qu'elle désire. Le film de John Carpenter est un petit bijou parfaitement
maîtrisé, plus fidèle à la nouvelle de John Campbell Jr que ne l'était la
précédente version. Les scènes dans lesquelles se manifestent les différentes
formes de la créature sont hallucinantes. Et la pression monte en même temps
que la paranoïa des protagonistes qui se rendent compte que le monstre peut
être l'un d'entre eux. Avec habileté et précision, Carpenter met les nerfs
du spectateur à rude épreuve et dissèque l'âme humaine. Treize ans après,
le film n'a rien perdu de sa force. Une intensité dramatique riche en surprises,
des effets spéciaux étonnants et la singularité de cette description d'un
monde apocalyptique fait de glace, de suspicion et de doute , donnent au film
une profondeur et une force rarement égalées. The Thing est la symbiose de
tout ce qui fait le talent du réalisateur qui innove sans cesse (même s'il
s'agit à la base d'un remake) et a même l'audace de laisser aux spectateurs
le soin d'imaginer
la fin du film.
Pourtant le succès n'est pas vraiment
au rendez-vous. Et le réalisateur enchaîne avec un projet moins ambitieux.
Même si John Carpenter avoue préférer Lovecraft, il était normal que l'un
des maîtres du fantastique -horrifique rencontre l'écrivain qui a le plus
marqué ce genre dernièrement : Stephen King. En 1983, il adapte donc CHRISTINE
en simplifiant l'intrigue pour se concentrer sur la ligne directrice. Un adolescent
mal dans sa peau tombe amoureux d'une bagnole cabossée qu'il décide de retaper.
Mais cette voiture est possédée et son esprit démoniaque et vengeur commence
à influencer le comportement du jeune homme. La ferraille et la chair s'affrontent
dans une mécanique huilée à la perfection, calibrée pour le succès et, du
coup, moins personnelle.
 Avec
STARMAN (1984), le cinéaste se lance alors dans une super-production produite
par Michael Douglas. Un extra-terrestre échoué sur Terre prend l'apparence
du mari décédé de Jenny. Contrainte et forcée, elle l'accompagne à travers
tout le pays jusqu'à l'endroit où doit atterrir un vaisseau de récupération.
Déjà génial, Jeff Bridges (encore peu connu) interprète cet E.T. maladroit
qui gagne peu à peu la confiance et l'amour de Jenny. Et surprise, ce film
est un road-movie romantique, plein de sensibilité, d'humour, et de tendresse.
Une nouvelle facette du réalisateur à laquelle personne ne s'attendait. Le
public, surpris, réserve au film un accueil mitigé. Une série, médiocre, poursuivra
cependant l'aventure à la télé. Avec
STARMAN (1984), le cinéaste se lance alors dans une super-production produite
par Michael Douglas. Un extra-terrestre échoué sur Terre prend l'apparence
du mari décédé de Jenny. Contrainte et forcée, elle l'accompagne à travers
tout le pays jusqu'à l'endroit où doit atterrir un vaisseau de récupération.
Déjà génial, Jeff Bridges (encore peu connu) interprète cet E.T. maladroit
qui gagne peu à peu la confiance et l'amour de Jenny. Et surprise, ce film
est un road-movie romantique, plein de sensibilité, d'humour, et de tendresse.
Une nouvelle facette du réalisateur à laquelle personne ne s'attendait. Le
public, surpris, réserve au film un accueil mitigé. Une série, médiocre, poursuivra
cependant l'aventure à la télé.
 Pas
découragé pour autant, Carpenter enchaîne en 1986 avec une autre grosse production,
Les Aventures de Jack Burton dans les Griffes du Mandarin (En vo : Big Trouble
in Little China !). Le film mélange allègrement magie noire, malédictions
chinoises, samouraïs, monstres globuleux et arts martiaux. Un camionneur un
peu balourd se trouve entraîné dans une folle histoire d'enlèvement au cœur
de Chinatown. Le voilà en pleine guerre de Triades, à lutter sous terre contre
des démons millénaires. Les spectateurs ont été décontenancés par ce film-hommage
parodique, à suivre au dixième degré, plus proche de l'esprit de Darkstar
que de The Thing. Pourtant cette oeuvre sous-estimée est visuellement délirante.
Quant à Kurt Russel dans le rôle de l'anti-héros maladroit qui arrive toujours
à la fin de l'action, il fait merveille. Ce film réjouissant mériterait bien
une seconde chance. En tout cas, c'est un échec cuisant pour le réalisateur.
Et comme il ne veut plus faire de concessions à Hollywood, il revient donc
à la série B, avec PRINCE DES TÉNÈBRES (1987). Pas
découragé pour autant, Carpenter enchaîne en 1986 avec une autre grosse production,
Les Aventures de Jack Burton dans les Griffes du Mandarin (En vo : Big Trouble
in Little China !). Le film mélange allègrement magie noire, malédictions
chinoises, samouraïs, monstres globuleux et arts martiaux. Un camionneur un
peu balourd se trouve entraîné dans une folle histoire d'enlèvement au cœur
de Chinatown. Le voilà en pleine guerre de Triades, à lutter sous terre contre
des démons millénaires. Les spectateurs ont été décontenancés par ce film-hommage
parodique, à suivre au dixième degré, plus proche de l'esprit de Darkstar
que de The Thing. Pourtant cette oeuvre sous-estimée est visuellement délirante.
Quant à Kurt Russel dans le rôle de l'anti-héros maladroit qui arrive toujours
à la fin de l'action, il fait merveille. Ce film réjouissant mériterait bien
une seconde chance. En tout cas, c'est un échec cuisant pour le réalisateur.
Et comme il ne veut plus faire de concessions à Hollywood, il revient donc
à la série B, avec PRINCE DES TÉNÈBRES (1987).
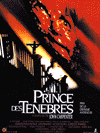 A
cette époque, tous les films d'horreur mettent de l'eau dans le vin, en mêlant
humour et terreur. John Carpenter, lui, persiste et signe un film flippant
qui retourne aux sources du fantastique, sans parasiter l'intrigue par un
humour de potache. II raconte l'expérience terrible vécue par un groupe de
scientifiques et d'étudiants dans une église de Los Angeles. Réunis par un
prêtre joué par Donald Pleasance, ils tentent d'élucider le mystère d'un étrange
sarcophage de verre qui contient un liquide fluorescent qui se révélera être
l'essence même du Mal. Prince des Ténèbres est un huis-clos oppressant. Avec
des bouts de ficelle, une horde impressionnante de clochards-zombies menée
par Alice Cooper et des effets spéciaux simples, John Carpenter montre qu'il
n'a pas perdu la main en réalisant un film particulièrement abouti qui met
métaphysique et religion au premier plan. Une thématique encore fortement
présente dans L'Antre de la Folie. A
cette époque, tous les films d'horreur mettent de l'eau dans le vin, en mêlant
humour et terreur. John Carpenter, lui, persiste et signe un film flippant
qui retourne aux sources du fantastique, sans parasiter l'intrigue par un
humour de potache. II raconte l'expérience terrible vécue par un groupe de
scientifiques et d'étudiants dans une église de Los Angeles. Réunis par un
prêtre joué par Donald Pleasance, ils tentent d'élucider le mystère d'un étrange
sarcophage de verre qui contient un liquide fluorescent qui se révélera être
l'essence même du Mal. Prince des Ténèbres est un huis-clos oppressant. Avec
des bouts de ficelle, une horde impressionnante de clochards-zombies menée
par Alice Cooper et des effets spéciaux simples, John Carpenter montre qu'il
n'a pas perdu la main en réalisant un film particulièrement abouti qui met
métaphysique et religion au premier plan. Une thématique encore fortement
présente dans L'Antre de la Folie.
John Carpenter est alors l'un des seuls maîtres du genre (avec Wes Craven)
à rester fidèle à son univers. Le seul à affirmer encore qu' "Ils"
sont là. "Ils", ce sont les extra-terrestres de THEY LIVE (Invasion
Los Angeles), tourné l'année suivante. Un SDF trouve des lunettes spéciales
qui lui révèlent une réalité parallèle plutôt inattendue. Des extra-terrestres
monstrueux se sont mélangés aux humains. Ils dirigent les postes "clés"
au gouvernement et ailleurs, exploitent les humains et endorment leurs consciences
à l'aide de messages subliminaux. Derrière la fable - parfois parodique -
et le film d'action se cache surtout un manifeste social et politique, une
claque au gouvernement Reaganien, un pamphlet subversif qui dénonce l'illusion
du progrès et les mensonges de la classe dominante. Et il ne reste plus au
héros de bidonville qu'à tirer dans le tas pour nettoyer tout ça.
Pourtant Carpenter s'assagit ensuite
avec son anecdotique Les Aventures d'un Homme Invisible (1992), un retour
au gros budget qui ne lui réussit pas. Les effets spéciaux d'ILM (la boîte
de Lucas) sont certes époustouflants mais le comique Chevy Chase, qui joue
le rôle titre, détone dans l'univers du cinéaste. Chase, par ailleurs aussi
producteur du film, a transformé l'expérience en véritable cauchemar pour
le réalisateur qui devant tant de pressions accumulées a failli renoncer à
faire du cinéma. II lui a fallu trois ans pour s'en remettre.
 Enfin
en 1994, il signe L'ANTRE DE LA FOLIE (sorti en France en février dernier).
Sam Neill campe un détective très cartésien, chargé de retrouver Sutter Cane,
le maître absolu du roman d'épouvante. Sa mission le mène à Hobb's End, une
petite ville qui n'est mentionnée nulle part sur les cartes. Normal, il s'agit
de la ville fictive dans laquelle se déroulent les intrigues des livres de
l'écrivain disparu! Bientôt l'enquêteur découvre que les sujets des livres
de Cane lui sont dictés par des extra-terrestres. Sous l'emprise de son prochain
roman, les lecteurs fanatisés vont bientôt tous devenir des meurtriers en
puissance, des déments violents. Incrédule, le détective commence un voyage
éprouvant qui le conduit peu à peu vers la folie. John Carpenter brouille
les cartes et manipule avec maestria ses personnages et le spectateur. Son
film vertigineux et plein d'humour noir fonctionne comme les poupées russes.
Réalité, fiction et rêve cauchemardesque s'emboîtent sans fin les uns dans
les autres. Du coup, le spectateur perd ses repères. Et si la réalité n'était
qu'une illusion ? Et si le libre-arbitre n'existait vraiment pas ? Le cinéaste
nous offre aussi une réflexion sur son métier, sur le cinéma d'horreur et
ses fans, se moquant ouvertement des clichés qui décrivent les spectateurs
et les réalisateurs de ce genre de films comme des crétins dégénérés et dangereux. Enfin
en 1994, il signe L'ANTRE DE LA FOLIE (sorti en France en février dernier).
Sam Neill campe un détective très cartésien, chargé de retrouver Sutter Cane,
le maître absolu du roman d'épouvante. Sa mission le mène à Hobb's End, une
petite ville qui n'est mentionnée nulle part sur les cartes. Normal, il s'agit
de la ville fictive dans laquelle se déroulent les intrigues des livres de
l'écrivain disparu! Bientôt l'enquêteur découvre que les sujets des livres
de Cane lui sont dictés par des extra-terrestres. Sous l'emprise de son prochain
roman, les lecteurs fanatisés vont bientôt tous devenir des meurtriers en
puissance, des déments violents. Incrédule, le détective commence un voyage
éprouvant qui le conduit peu à peu vers la folie. John Carpenter brouille
les cartes et manipule avec maestria ses personnages et le spectateur. Son
film vertigineux et plein d'humour noir fonctionne comme les poupées russes.
Réalité, fiction et rêve cauchemardesque s'emboîtent sans fin les uns dans
les autres. Du coup, le spectateur perd ses repères. Et si la réalité n'était
qu'une illusion ? Et si le libre-arbitre n'existait vraiment pas ? Le cinéaste
nous offre aussi une réflexion sur son métier, sur le cinéma d'horreur et
ses fans, se moquant ouvertement des clichés qui décrivent les spectateurs
et les réalisateurs de ce genre de films comme des crétins dégénérés et dangereux.
Le 16 août sort sur les écrans son dernier film, LE VILLAGE DES DAMNES, avec
Christopher Reeve, Kirstie Alley, Linda Kozlowski, Mark Hamill et Michael
Paré. Des enfants aux pouvoirs mystérieux bouleversent la vie d'une petite
bourgade de Province. Ils ont tous été conçus le même jour; le jour où une
force invisible a plongé tout le village dans un profond sommeil, déclenchant
des grossesses chez dix femmes. Bientôt, les morts accidentelles se multiplient
et les habitants doivent se rendre à l'évidence : "leurs" enfants
ne sont pas humains. Le Village des Damnés risque de décevoir les fans de
John Carpenter. L'originalité et le rythme, propres aux précédentes œuvres
du maître, sont absents de ce remake pour une fois peu inspiré et plutôt répétitif.
Même si le film entend dénoncer la perte des valeurs morales d'une certaine
jeunesse actuelle, celle qui ne parvient plus à faire la différence entre
le bien et le mal, il faut avouer que John Carpenter n'a pas exploré toutes
les pistes que lui offrait un tel sujet. S'il n'y avait pas eu récemment L'Antre
de la Folie, on pourrait se poser des questions. Mais il ne s'agit vraisemblablement
que d'une petite baisse de forme passagère, sur un film qui ressemble fort
à un commande. Ce qui ne saurait entamer notre foi en ce cinéaste du troisième
type.
Aventures délirantes, films métaphysiques
de terreur pure, comédie et road-movie sentimental, films d'action engagés,
ou westerns urbains, John Carpenter a donc décliné le fantastique sous toutes
ces formes, en y mélangeant tous les genres. Touche à tout, véritable homme-orchestre,
il a imposé un style visuel nouveau, un label de qualité dans la série B,
tout en réussissant à transformer - à une rare exception près - les essais
des films à gros budget qui lui ont été confiés. II a su renouveler complètement
un genre en perdition. En évitant les effet faciles et, avant tout, en s'appuyant
sur une véritable structure narrative, avec progression dramatique et personnages
variés. Ses héros, ses histoires, les lieux où il les situe, tranchent avec
les productions classiques. Et témoignent de son inventivité. Revue par lui,
chaque recette du genre redevient originale. Car le cinéaste a apporté un
regard personnel et novateur. II a toujours la petite idée en plus, qui fait
la différence. Ainsi, en l'espace de 14 films (plus trois téléfilms, trois
productions et six scénarios adaptés par d'autres), il prouve qu'il a bel
et bien mérité qu'on le reconnaisse comme un auteur à part entière. Maintenant,
on aimerait aussi le retrouver au générique d'un Western, un vrai. Comme Impitoyable
(le film de Clint Eastwood) qu'il admire. Car au départ, John Carpenter est
bien devenu réalisateur pour faire des westerns. Seulement le genre, à l'époque
de ses débuts, était passé de mode. Aujourd'hui, c'est toujours son rêve.
II en meurt d'envie. Et, finalement, on est tout aussi impatient que lui .
(c) juillet 96
|
 Avec
STARMAN (1984), le cinéaste se lance alors dans une super-production produite
par Michael Douglas. Un extra-terrestre échoué sur Terre prend l'apparence
du mari décédé de Jenny. Contrainte et forcée, elle l'accompagne à travers
tout le pays jusqu'à l'endroit où doit atterrir un vaisseau de récupération.
Déjà génial, Jeff Bridges (encore peu connu) interprète cet E.T. maladroit
qui gagne peu à peu la confiance et l'amour de Jenny. Et surprise, ce film
est un road-movie romantique, plein de sensibilité, d'humour, et de tendresse.
Une nouvelle facette du réalisateur à laquelle personne ne s'attendait. Le
public, surpris, réserve au film un accueil mitigé. Une série, médiocre, poursuivra
cependant l'aventure à la télé.
Avec
STARMAN (1984), le cinéaste se lance alors dans une super-production produite
par Michael Douglas. Un extra-terrestre échoué sur Terre prend l'apparence
du mari décédé de Jenny. Contrainte et forcée, elle l'accompagne à travers
tout le pays jusqu'à l'endroit où doit atterrir un vaisseau de récupération.
Déjà génial, Jeff Bridges (encore peu connu) interprète cet E.T. maladroit
qui gagne peu à peu la confiance et l'amour de Jenny. Et surprise, ce film
est un road-movie romantique, plein de sensibilité, d'humour, et de tendresse.
Une nouvelle facette du réalisateur à laquelle personne ne s'attendait. Le
public, surpris, réserve au film un accueil mitigé. Une série, médiocre, poursuivra
cependant l'aventure à la télé.  Pas
découragé pour autant, Carpenter enchaîne en 1986 avec une autre grosse production,
Les Aventures de Jack Burton dans les Griffes du Mandarin (En vo : Big Trouble
in Little China !). Le film mélange allègrement magie noire, malédictions
chinoises, samouraïs, monstres globuleux et arts martiaux. Un camionneur un
peu balourd se trouve entraîné dans une folle histoire d'enlèvement au cœur
de Chinatown. Le voilà en pleine guerre de Triades, à lutter sous terre contre
des démons millénaires. Les spectateurs ont été décontenancés par ce film-hommage
parodique, à suivre au dixième degré, plus proche de l'esprit de Darkstar
que de The Thing. Pourtant cette oeuvre sous-estimée est visuellement délirante.
Quant à Kurt Russel dans le rôle de l'anti-héros maladroit qui arrive toujours
à la fin de l'action, il fait merveille. Ce film réjouissant mériterait bien
une seconde chance. En tout cas, c'est un échec cuisant pour le réalisateur.
Et comme il ne veut plus faire de concessions à Hollywood, il revient donc
à la série B, avec PRINCE DES TÉNÈBRES (1987).
Pas
découragé pour autant, Carpenter enchaîne en 1986 avec une autre grosse production,
Les Aventures de Jack Burton dans les Griffes du Mandarin (En vo : Big Trouble
in Little China !). Le film mélange allègrement magie noire, malédictions
chinoises, samouraïs, monstres globuleux et arts martiaux. Un camionneur un
peu balourd se trouve entraîné dans une folle histoire d'enlèvement au cœur
de Chinatown. Le voilà en pleine guerre de Triades, à lutter sous terre contre
des démons millénaires. Les spectateurs ont été décontenancés par ce film-hommage
parodique, à suivre au dixième degré, plus proche de l'esprit de Darkstar
que de The Thing. Pourtant cette oeuvre sous-estimée est visuellement délirante.
Quant à Kurt Russel dans le rôle de l'anti-héros maladroit qui arrive toujours
à la fin de l'action, il fait merveille. Ce film réjouissant mériterait bien
une seconde chance. En tout cas, c'est un échec cuisant pour le réalisateur.
Et comme il ne veut plus faire de concessions à Hollywood, il revient donc
à la série B, avec PRINCE DES TÉNÈBRES (1987).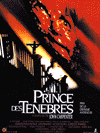 A
cette époque, tous les films d'horreur mettent de l'eau dans le vin, en mêlant
humour et terreur. John Carpenter, lui, persiste et signe un film flippant
qui retourne aux sources du fantastique, sans parasiter l'intrigue par un
humour de potache. II raconte l'expérience terrible vécue par un groupe de
scientifiques et d'étudiants dans une église de Los Angeles. Réunis par un
prêtre joué par Donald Pleasance, ils tentent d'élucider le mystère d'un étrange
sarcophage de verre qui contient un liquide fluorescent qui se révélera être
l'essence même du Mal. Prince des Ténèbres est un huis-clos oppressant. Avec
des bouts de ficelle, une horde impressionnante de clochards-zombies menée
par Alice Cooper et des effets spéciaux simples, John Carpenter montre qu'il
n'a pas perdu la main en réalisant un film particulièrement abouti qui met
métaphysique et religion au premier plan. Une thématique encore fortement
présente dans L'Antre de la Folie.
A
cette époque, tous les films d'horreur mettent de l'eau dans le vin, en mêlant
humour et terreur. John Carpenter, lui, persiste et signe un film flippant
qui retourne aux sources du fantastique, sans parasiter l'intrigue par un
humour de potache. II raconte l'expérience terrible vécue par un groupe de
scientifiques et d'étudiants dans une église de Los Angeles. Réunis par un
prêtre joué par Donald Pleasance, ils tentent d'élucider le mystère d'un étrange
sarcophage de verre qui contient un liquide fluorescent qui se révélera être
l'essence même du Mal. Prince des Ténèbres est un huis-clos oppressant. Avec
des bouts de ficelle, une horde impressionnante de clochards-zombies menée
par Alice Cooper et des effets spéciaux simples, John Carpenter montre qu'il
n'a pas perdu la main en réalisant un film particulièrement abouti qui met
métaphysique et religion au premier plan. Une thématique encore fortement
présente dans L'Antre de la Folie.  Enfin
en 1994, il signe L'ANTRE DE LA FOLIE (sorti en France en février dernier).
Sam Neill campe un détective très cartésien, chargé de retrouver Sutter Cane,
le maître absolu du roman d'épouvante. Sa mission le mène à Hobb's End, une
petite ville qui n'est mentionnée nulle part sur les cartes. Normal, il s'agit
de la ville fictive dans laquelle se déroulent les intrigues des livres de
l'écrivain disparu! Bientôt l'enquêteur découvre que les sujets des livres
de Cane lui sont dictés par des extra-terrestres. Sous l'emprise de son prochain
roman, les lecteurs fanatisés vont bientôt tous devenir des meurtriers en
puissance, des déments violents. Incrédule, le détective commence un voyage
éprouvant qui le conduit peu à peu vers la folie. John Carpenter brouille
les cartes et manipule avec maestria ses personnages et le spectateur. Son
film vertigineux et plein d'humour noir fonctionne comme les poupées russes.
Réalité, fiction et rêve cauchemardesque s'emboîtent sans fin les uns dans
les autres. Du coup, le spectateur perd ses repères. Et si la réalité n'était
qu'une illusion ? Et si le libre-arbitre n'existait vraiment pas ? Le cinéaste
nous offre aussi une réflexion sur son métier, sur le cinéma d'horreur et
ses fans, se moquant ouvertement des clichés qui décrivent les spectateurs
et les réalisateurs de ce genre de films comme des crétins dégénérés et dangereux.
Enfin
en 1994, il signe L'ANTRE DE LA FOLIE (sorti en France en février dernier).
Sam Neill campe un détective très cartésien, chargé de retrouver Sutter Cane,
le maître absolu du roman d'épouvante. Sa mission le mène à Hobb's End, une
petite ville qui n'est mentionnée nulle part sur les cartes. Normal, il s'agit
de la ville fictive dans laquelle se déroulent les intrigues des livres de
l'écrivain disparu! Bientôt l'enquêteur découvre que les sujets des livres
de Cane lui sont dictés par des extra-terrestres. Sous l'emprise de son prochain
roman, les lecteurs fanatisés vont bientôt tous devenir des meurtriers en
puissance, des déments violents. Incrédule, le détective commence un voyage
éprouvant qui le conduit peu à peu vers la folie. John Carpenter brouille
les cartes et manipule avec maestria ses personnages et le spectateur. Son
film vertigineux et plein d'humour noir fonctionne comme les poupées russes.
Réalité, fiction et rêve cauchemardesque s'emboîtent sans fin les uns dans
les autres. Du coup, le spectateur perd ses repères. Et si la réalité n'était
qu'une illusion ? Et si le libre-arbitre n'existait vraiment pas ? Le cinéaste
nous offre aussi une réflexion sur son métier, sur le cinéma d'horreur et
ses fans, se moquant ouvertement des clichés qui décrivent les spectateurs
et les réalisateurs de ce genre de films comme des crétins dégénérés et dangereux.